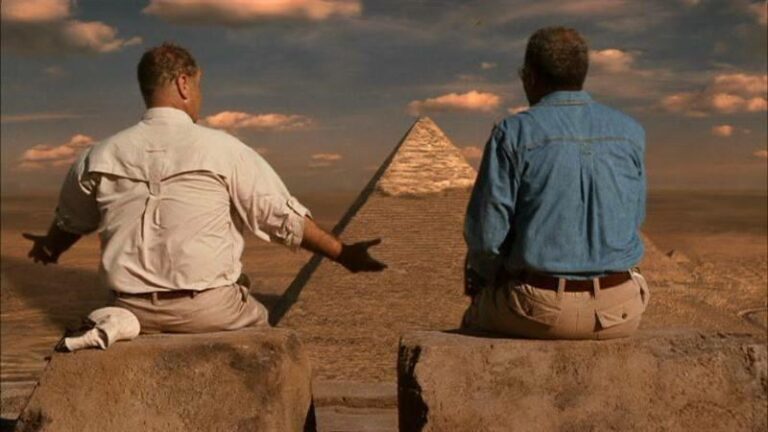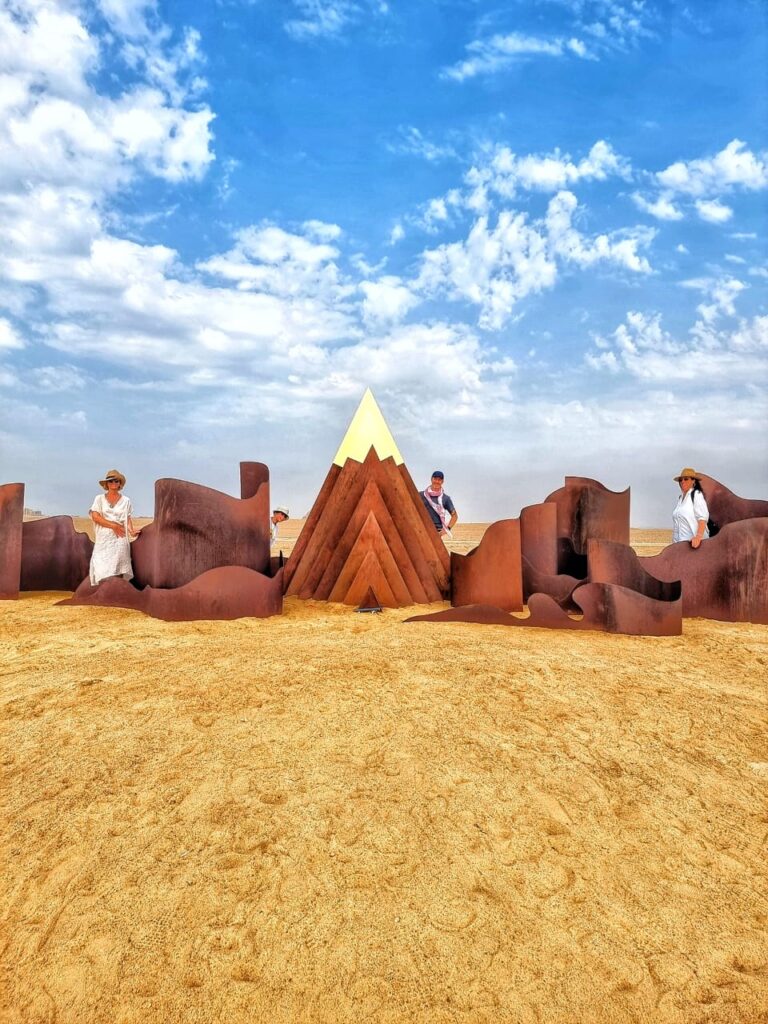L’Égypte et le Nil ont été une source d’inspiration pour de nombreux écrivains. Parmi ceux qui ont écrit sur leurs expériences, il y a beaucoup de femmes qui, peut-être initialement attirées par les temples et les tombes de l’Égypte ancienne, ont également partagé avec leurs lecteurs des détails fascinants sur la vie en Égypte pendant les périodes où elles l’ont visitée ou y ont vécu.
« On se demande comment les gens peuvent revenir d’Égypte et vivre leur vie comme avant. » – Florence Nightingale
Voyager pour les femmes aux XIXe et au début du XXe siècle signifiait échapper, du moins temporairement, aux exigences et attentes de leur société, tout en leur permettant de découvrir des cultures significativement différentes de la leur. Les voyageuses expérimentaient souvent et percevaient leur environnement et les personnes qu’elles rencontraient différemment des hommes. Elles avaient (et ont toujours) la capacité d’offrir aux lecteurs des perspectives uniques, surtout parce qu’elles avaient parfois accès à des endroits où les hommes ne pouvaient pas entrer.
Bien que les sociétés dont elles venaient changeaient lentement, beaucoup de femmes avaient encore une autodétermination limitée ou peu d’opportunités pour s’exprimer et partager leurs idées. Écrire sur l’Égypte et son impact sur elles leur permettait d’exprimer librement leurs opinions sur de nombreux sujets. Cela a conduit certaines à changer radicalement de vie après leur séjour en Égypte. Leurs expériences de voyage n’ont pas seulement élargi leurs horizons d’un point de vue physique, mais ont également contribué à leur développement mental et spirituel.
Carl Thompson décrit justement : « Si la voyageuse défie l’idéologie patriarcale des sphères séparées en quittant son foyer et en s’aventurant dans le monde, l’écrivaine de voyage, ou du moins la femme qui publie un récit de voyage, défie cette idéologie deux fois. »
Cependant, aussi enrichissantes soient leurs expériences, leurs écrits nous révèlent aussi leurs préjugés et attitudes négatives. Beaucoup de voyageuses arrivaient en Égypte avec des fantasmes orientalistes que la réalité ne satisfaisait pas toujours, et leurs récits étaient souvent jugeants. Tandis que certaines ont remis en question les stéréotypes et les suppositions que leurs sociétés et elles-mêmes avaient sur l’Égypte et ses habitants, d’autres ont trouvé trop difficile de comprendre ou d’accepter les modes de vie qu’elles observaient.
Certains de ces préjugés étaient liés au colonialisme et à l’idée que l’Occident était civilisé et éclairé, tandis que l’Orient était primitif voire sauvage. Beaucoup de voyageuses apportaient avec elles des stéréotypes et des généralisations qui s’accordaient avec les visions orientalistes des femmes égyptiennes. Bien qu’elles aient eu plus d’opportunités que les voyageurs masculins pour rencontrer des femmes locales, cela était parfois limité par la timidité ou l’isolement de ces femmes égyptiennes. De plus, certaines écrivaines ne pouvaient partager qu’une vision subjective des femmes et des harems en raison de leur propre contexte social ou religieux. Bien qu’elles écrivaient dans l’intention d’informer, elles étaient peut-être prudentes de ne pas offenser la sensibilité de leurs lecteurs.
La capacité d’offrir des visions objectives était également limitée, car leurs perspectives sur les femmes locales ne prenaient pas toujours en compte le rôle de la femme dans une société musulmane. Beaucoup de voyageuses considéraient les habitants comme faisant partie du grand spectacle de l’Égypte qu’elles traversaient, au lieu de les considérer comme des personnes réelles. Souvent, les visiteurs étaient plus intéressés par les monuments anciens que par la vie des Égyptiens. Cependant, certaines, après avoir passé plus de temps dans le pays, ont changé leur vision initiale et ont compris qu’il existait d’autres façons de vivre et de penser.
Certaines écrivaines étaient plus conscientes de la nécessité de regarder au-delà de leur propre cadre de référence. Par exemple, Harriet Martineau n’a pas été impressionnée par le grand nombre d’animaux momifiés, mais a déclaré : « Nous devrions comprendre avant de mépriser, et, généralement, plus nous comprenons, moins nous méprisons. »
Il y avait aussi des préjugés sur les façons de voyager en Égypte. Thomas Cook a introduit une nouvelle manière de parcourir le Nil avec des forfaits touristiques sur des bateaux à vapeur, qui isolaient encore plus les voyageurs du pays et de son peuple. Ceux qui avaient de l’argent et du temps pour louer un bateau privé considéraient cela comme la manière la plus romantique d’explorer l’Égypte. Comme l’a commenté Carl Thompson : « Un trait récurrent dans de nombreux récits de voyage victoriens est une rhétorique anti-touristique qui cherche à distinguer l’auteur de la vulgaire ‘foule’ de touristes. »
Les écrivaines que nous présentons ici ont voyagé et vécu en Égypte de différentes manières et pour diverses raisons, il est donc naturel que leurs récits diffèrent, bien qu’ils partagent également de nombreuses similitudes. Par exemple, Sophia Lane Poole et Lucie Duff Gordon ont vécu en Égypte pendant des années, ce qui leur a permis d’étudier et de mieux comprendre les habitants locaux. Bien qu’elles soient restées des étrangères culturelles, leurs écrits ont offert un équilibre par rapport aux publications de visiteurs à court terme.
D’autres voyageuses, comme Florence Nightingale et Maria Georgina Shirreff Grey, étaient simplement des touristes, mais leurs observations restent précieuses, bien que leurs perspectives aient été moins flexibles. Leurs écrits révèlent à la fois leurs propres préjugés et ceux de leurs sociétés. Shirreff Grey est apparemment restée indifférente à ce qu’elle a vu. Nightingale, en revanche, a amélioré son attitude envers l’Égypte pendant son voyage, bien que le changement ait été plus dans son appréciation des monuments anciens que dans sa vision des habitants contemporains.
Les visites de Harriet Martineau et Amelia Edwards étaient séparées de près de 30 ans. Toutes deux étaient des écrivaines indépendantes et déterminées, intéressées par plus que simplement raconter une histoire de voyage. L’Égypte a changé leur vie et déterminé leur trajectoire bien après leurs voyages.
Au siècle suivant, des écrivaines comme Agatha Christie et Elizabeth Peters nous ont offert des romans imaginatifs influencés par la connaissance croissante de l’Égypte. La littérature de voyage nous fournit des visions différentes d’un pays, des perspectives qui ont été façonnées non seulement par ce que les voyageuses ont vu et vécu, mais aussi par la culture de l’auteure et du lecteur. Ces livres doivent être lus en tenant compte de cela.
Cependant, il est encourageant de noter qu’en lisant plusieurs de ces écrivaines, il devient évident que leurs points de vue et préjugés ont parfois été transformés par leurs expériences. Bien que la littérature de voyage européenne ait souvent été « un véhicule pour l’expression de l’arrogance eurocentrique ou de l’intolérance raciste », heureusement certaines écrivaines ont réussi à « surmonter la distance culturelle par un acte prolongé de compréhension ».
(citation de Dennis Porter, Haunted Journeys: Desire and Transgression in European Travel Writing, Princeton University Press, 1991).
Voici une sélection de livres écrits par des femmes sur l’Égypte ou inspirés par leurs expériences là-bas. Vous pouvez trouver d’autres recommandations sur notre tableau Pinterest, où nous ajoutons régulièrement des livres et des magazines sur une grande variété de sujets liés à l’Égypte : 🔗 https://www.pinterest.com/realegypt/books-about-egypt/
LIVRES ET ÉCRIVAINES
- The Englishwoman in Egypt: Letters from Cairo, écrit pendant un séjour en 1842 – Sophia Lane Poole
- Eastern Life, Present and Past (1848) – Harriet Martineau
- Letters from Egypt, A Journey on the Nile, 1849-1850 – Florence Nightingale
- A Thousand Miles up the Nile – Amelia Edwards (1876, deuxième édition 1888)
- Letters from Egypt, 1863-65 and Last Letters from Egypt – Lucie Duff Gordon
Wayfarers in the Libyan Desert – Lady Evelyn Cobbold (1912)